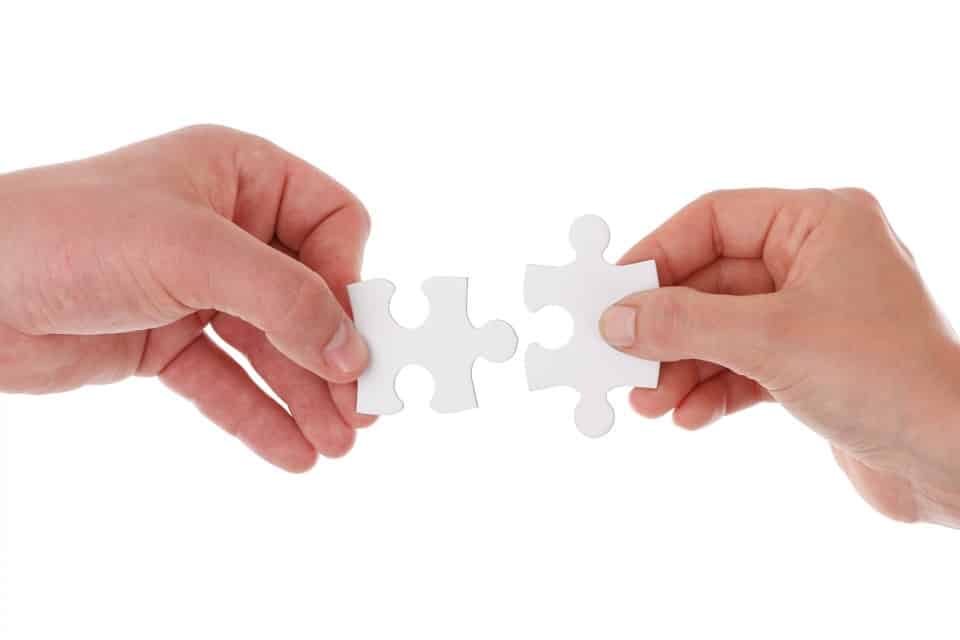Dire qu’une école se gère comme une entreprise, c’est confondre deux mondes qui se frôlent sans jamais vraiment se ressembler. Les classements d’écoles de commerce fascinent, obsèdent, tracent des lignes de démarcation invisibles dans la tête des candidats comme des étudiants. Pourtant, une vérité s’impose : aucun classement d’école de commerce n’est gravé dans le marbre.
Ce que racontent les étudiants
Sur les forums, sur les réseaux, la bataille des classements fait rage. Les écoles sont disséquées, hiérarchisées, défendues bec et ongles par leurs élèves. Les débats s’enflamment pour savoir si telle école mérite vraiment de figurer devant telle autre. On entend tout : « il y a les parisiennes et le reste », « le top 5, puis tout le reste », « le top 10, puis les autres ». Pour beaucoup, l’école devient un totem, et son rang, une part de leur identité. L’attachement perdure bien au-delà du diplôme : une appartenance qui s’affiche, s’assume, revendique parfois un peu trop fort.
Le regard des entreprises, des recruteurs, des responsables
Du côté des recruteurs, la réalité est plus nuancée. Oui, certains grands groupes établissent des listes d’écoles à privilégier, avec parfois des barèmes de salaire pour chaque nom. Ce réflexe se retrouve surtout dans les secteurs les plus convoités, comme le conseil en stratégie ou le luxe, où les candidatures affluent. Là, le nom de l’école peut servir de premier filtre. Mais pour la majorité des entreprises, grandes ou petites, les nuances de classement s’estompent vite. Les DRH savent bien distinguer les écoles reconnues, celles qui font le job, et celles qui peinent à convaincre. Pourtant, rares sont ceux capables de réciter la position précise d’une école dans chaque palmarès, ni même d’expliquer pourquoi une école progresse ou recule d’un rang.
Une étude LinkedIn menée auprès de 16 000 DRH va d’ailleurs dans ce sens : interrogés sur leur façon de recruter des cadres issus d’écoles de commerce, la grande majorité affirme ne pas faire de distinction stricte. Les différences de salaire à l’embauche ne se jouent pas sur le rang exact au classement. Ce qui prime ? Les compétences, l’attitude, la capacité à s’adapter. Bien sûr, disposer d’un diplôme d’une école notoire ouvre des portes, mais au quotidien, c’est la personne qui fait la différence, pas le chiffre sur le podium.
Comment lire, et relativiser, les classements ?
Les classements répondent à un besoin : comparer, ordonner, simplifier un choix complexe. Mais il faut garder un œil critique sur leur élaboration et leurs biais. Voici plusieurs aspects à considérer pour comprendre ce qui se cache derrière ces palmarès :
- Les classements ne sont jamais officiels : chaque magazine ou organisme choisit ses propres critères, pondère à sa façon, cherche à se distinguer de la concurrence sans trop bousculer l’ordre établi.
- Les critères varient fortement : nombre d’enseignants, proportion d’internationaux, publications, taux d’insertion, présence à l’étranger, frais de scolarité… Certains paramètres sont pertinents, d’autres prêtent à discussion, et leur pondération relève souvent de l’arbitraire.
- Les informations utilisées sont parfois invérifiables ou orientées : écoles et étudiants ont tout intérêt à présenter leur établissement sous le meilleur jour, quitte à enjoliver les réponses aux enquêtes ou à minimiser les points faibles.
- Il n’est pas rare de voir une même école classée 8e ici, 15e là, ou de grimper et descendre de plusieurs places selon les années, sans transformation majeure en interne.
Patrick Fauconnier, fondateur du magazine Challenges, ne mâche pas ses mots : « c’est la foire aux chiffres arrangés : salaires, départs internationaux, nombre d’enseignants… Seules les données des concours, comme celles du SIGEM, tiennent vraiment la route. »
Classements : des verdicts relatifs, jamais définitifs
Un classement donne une photo à l’instant T, mais il ne dit pas tout. La différence entre le premier et le dernier du palmarès est réelle, mais elle occulte un point fondamental : seuls une quarantaine d’établissements figurent dans ces listes. En France, on recense entre 250 et 300 écoles de commerce. La plupart des classements se concentrent sur celles qui délivrent le grade de Master et bénéficient déjà d’une certaine reconnaissance. À titre de comparaison, il existe environ 200 écoles d’ingénieurs. Se retrouver en queue de classement ne signifie donc pas que l’école est « mauvaise », simplement qu’elle figure déjà dans un cercle restreint.
Autre effet pervers : la manie de vouloir absolument départager deux écoles proches. Faut-il vraiment distinguer la 10e de la 11e ? Cette obsession du classement tranche à coups de décimales, alors que, dans les faits, la frontière est souvent floue. Le fameux « top 10 » est-il universel ? Chacun a sa version, étudiants, entreprises, responsables RH… et l’école placée juste après ce seuil symbolique se retrouve reléguée à tort, comme si elle avait raté le coche.
Les classements rassurent, structurent, mais ils ne remplacent ni l’expérience vécue, ni le chemin personnel. Sous la surface des chiffres, derrière l’arbitraire des rangs, il y a la réalité d’un parcours, les rencontres, les projets. À force de vouloir tout mesurer, on finit par oublier l’essentiel : c’est ce que l’on fait de son passage à l’école qui compte, bien plus que la place sur un tableau d’honneur éphémère.